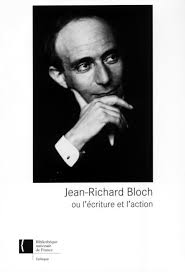
par Tivadar Gorilovics
Article paru d’abord en espagnol sous le titre Entre los engranajes de un compromiso (Jean-Richard Bloch en la dirección de Ce Soir”, dans ¡Espana ! ¡Espana ! Un intelectual en le siglo. Jean-Richard Bloch, Carme Figuerola (éd.). Lleida, Pagès editors, Collección El Fil d’Ariadna, Serie Literatura, 1996, p. 289-304. La version française a été publiée dans la Revue d’Études Françaises de Budapest, N° 2, 1997, p. 321-330.
Tivadar Gorilovics
Dans l’engrenage d’un engagement
Jean-Richard Bloch à la direction de Ce soir
L’aventure, tout au moins pour Jean-Richard Bloch, commence le 13 janvier 1937, avec l’arrivée « en pleine nuit », dans sa maison de Poitiers, à la Mérigote, de Louis Aragon, qui ne lui demande pas moins que d’accepter la direction, avec lui, d’un nouveau journal du soir qu’il s’agit de lancer dès le 1er mars et dont le succès ne dépendrait plus que de sa réponse. L’hôte de la Mérigote émerge à peine d’une crise de surmenage aigu, le bon sens le plus élémentaire devrait donc lui conseiller de dire non. Il dira oui, quitte à s’en repentir par la suite bien des fois, le plus amèrement peut-être dans sa lettre du 27 juin 1939 à Romain Rolland [1] : « Je n’en peux plus. Et s’il m’advient de m’éveiller, la nuit, l’angoisse, le regret, prennent possession de mon esprit et je sombre dans le désespoir. Que suis-je venu faire dans cette galère où Aragon de son côté a laissé déjà une partie de sa santé ? »
L’histoire de ce oui connaît deux versions, suivant qu’elle est relatée par l’un ou l’autre des deux protagonistes. Celle de Bloch, relativement tardive, néanmoins contemporaine encore des faits : sa lettre du 21 octobre 1937 à Roger Martin du Gard [2] ; celle d’Aragon, sensiblement postérieure, puisque rédigée quarante ans plus tard, en 1976 [3]. La première parle de surprise, en mettant l’accent sur les hésitations du futur directeur ; la seconde prétend que l’accueil de Jean-Richard Bloch fut d’emblée compréhensif et favorable. Quoi qu’il en soit, ces deux récits, car il s’agit bien de récits, rétrospectifs et orchestrés, n’offrent qu’une image quelque peu approximative de l’événement, tel qu’il fut vécu par Bloch au moment même où il se produisit. Il fallait attendre 1987, la publication de l’ouvrage de Carlos Serrano, pour connaître enfin deux documents strictement contemporains de l’acte d’engagement par lequel Jean-Richard Bloch s’est attaché à la « galère » de Ce soir. [4]
Pour apprécier correctement la réelle valeur documentaire de la lettre du 21 octobre 1937, il faut surtout tenir compte du fait qu’elle apporte un témoignage largement conditionné par la personne du destinataire : elle remplit une fonction à la fois explicative et justificative. C’est que Roger Martin du Gard, ce vieil ami de jeunesse, est sur le point de publier les trois volumes de L’Été 1914, achevé comme de juste au mois de mars de la même année, fournissant ainsi un exemple de labeur soutenu et productif. Sans doute cet ami, quelques années auparavant, à propos de ses Commentaires d’Europe, ne lui marchandait pas ses compliments [5] :
« L’évolution de ta pensée me surprend sans cesse », lui écrivait-il le 18 décembre 1930. « J’en admire les rebondissements perpétuels. Je t’envie. Je me sens terriblement limité par mon œuvre, mis sous cloche. » Mais ce compliment ne laissait-il pas entendre du même coup que lui, Bloch, n’avait pas à gérer une œuvre ? Comment justifier alors aux yeux de cet ami à la fois fidèle et exigeant ce qui s’est passé ? Tout le premier paragraphe de la lettre est rédigé de façon qu’il puisse entrer dans une éloquente antithèse, celle des intentions premières et des faits qui devaient les démentir :
« Il y a, aujourd’hui, neuf mois et une semaine... Je venais de rentrer à Poitiers depuis la Noël ; après deux ou trois années troublées (le 6 février, l’U.R.S.S., ma santé compromise et, par là-dessus, l’Espagne tout à coup), je venais de résilier ma location de pied à terre à Paris, je me retirais du tohu-bohu, je partais pour la montagne d’abord, le midi ensuite ; une grande année – ou deux – de travail solitaire ; mes livres devant moi ; la fin de l’Aigle et Ganymède, une pièce ; etc. ... »
Une grande année – ou deux – de travail solitaire ? Sa lettre à André Monglond, qui date pourtant du 10 janvier 1937, n’en soufflait pas un mot [6] : « Rentré ici à la Noël, lui écrivait-il, j’y reste au travail tant que je m’y prendrai en patience. Ensuite ce sera la montagne ou le Midi jusqu’à la mi-mars, où ce sera Lourdes d’abord, puis Paris (répétitions de ma prochaine pièce). »
Se prendre en patience, voilà ce qui correspond davantage à ce que nous savons du tempérament de ce grand inquiet. La suite raconte la visite d’Aragon, non sans soulever toute une série de questions auxquelles J.-R. Bloch tantôt refuse de répondre, tantôt préfère les laisser en suspens pour mettre ensuite toute son histoire – sur le compte du diable (« Damnable curiosité du fils d’Ève »), ce dernier étant apparemment aussi l’artisan du succès du journal. Et ce succès imprévu, du même coup, confère à son aventure « un côté magnifique et passionnant », bref une justification qui, pour n’être pas d’ordre littéraire, n’en a pas moins de poids à ses yeux, sur un plan qu’il laissera toutefois volontairement dans l’ombre, sachant bien que des arguments de militant n’avaient guère de chances de convaincre un interlocuteur comme Roger Martin du Gard [7] :
« Le 15 janvier, précédé par deux télégrammes énigmatiques [8] , Aragon débarquait à la Mérigote, en pleine nuit. Comment me suis-je laissé aller à donner une réponse qui ne fût pas un non, – le non qui avait jailli d’instinct de ma bouche, à la première phrase qu’il m’avait touchée de ses projets ? [...]
Je passe sur les heures de discussion qui ont abouti à un oui temporaire et révocable. Ce oui, je l’ai donné. A tort ? A raison ? Qui le sait ? Quand le saurai-je ? Je suis arrivé à Paris le 16 janvier avec une valise pour 48 heures.
Pour voir.
J’y suis encore. Je n’en suis pas reparti. Damnable curiosité du fils d’Ève ; c’est elle qui m’a fourré dans cette aventure, qui a un côté magnifique et passionnant (puisque ce journal a réussi au-delà de toute espérance et sans rapport avec aucun précédent, dans l’histoire de la presse française), un côté pitoyable et caricatural. »
Que les premières réactions de Jean-Richard Bloch aient été de surprise et de refus, d’où des heures de discussion avec son visiteur, cela est confirmé par le Brouillon de lettre qui insiste en plus sur l’efficacité persuasive d’Aragon dont on ne saurait ici surestimer le rôle (j’y reviendrai encore) [9] :
« Lorsqu’Aragon est venu me trouver à Poitiers, le 13, j’étais loin de me douter de ce qui motivait sa démarche. Après 20 heures de conversation et de réflexions, devant son insistance à la fois habile et affectueuse, j’ai fini par donner mon acquiescement, à la condition qu’il fût bien entendu pour vous et pour lui qu’il s’agit d’une acceptation provisoire, temporaire, limitée à la mise en route du travail. »
La lettre du 21 octobre, pour des raisons que l’on devine neuf mois après, passe sous silence le caractère provisoire de l’acceptation, tout en mettant en relief ses conséquences pour la santé :
« Bref, j’ai traversé des fatigues telles qu’il me faut remonter à la guerre – et à l’agrégation – pour en trouver d’équivalentes. Depuis neuf mois je n’ai pas ouvert un livre, lu un livre. Je me suis instruit de mille choses terribles et bouffonnes, peut-être dix ans trop tard. [...] Et maintenant je songe à des vacances. Voilà quatre mois que je n’ai même pas pris mon jour de repos hebdomadaire. Je vis depuis trois trimestres dans cet enfer de macadam, de ciment, d’acier, de pétrole et de fracas, sans avoir revu les arbres. »
Le surmenage est au demeurant un véritable leitmotiv de cette période qui va en fait de l’automne 1936 jusqu’à l’été 1939, lorsque, dans sa lettre déjà citée du 27 juin à Romain Rolland, Jean-Richard Bloch pousse le même gémissement : « depuis des mois, je n’ai pas lu un livre, Aragon absent du journal, depuis des mois, lui aussi, – ma charge est doublée, les événements ne la rendent pas plus légère, ni mes responsabilités triquotidiennes (autant que d’éditions) moins pesantes. Mes semaines y passent toutes, je ne sais plus ce que c’est qu’une journée de repos. ».
Dans l’argumentation que J.-R. Bloch met en œuvre dans son Brouillon de lettre pour justifier le caractère provisoire de son oui, ce motif du surmenage est du reste lié (comme il restera lié dans sa lettre à R.M.G.) à son activité d’intellectuel engagé depuis 1934 : « Cette proposition m’a surpris dans un moment où je me rétablissais à peine de la crise de surmenage aigu dont j’ai payé mes trois campagnes de meetings et de propagande, – aprés le 6 février, – après mon retour d’URSS, – après mon retour d’Espagne. »
A vrai dire, ces problèmes de santé ne le quittent plus depuis la guerre, et on se rappellera à ce propos ce qu’il en avait dit à Roger Martin du Gard [10] :
« Ma carcasse me fait payer chaque semaine de travail d’une semaine de malaises. Je suis comme un homme qui, depuis des années, ne vivrait que six mois par an. »
En acceptant la co-direction de Ce soir, même à titre provisoire, J.-R. Bloch consent à prolonger, et même à aggraver cet état de surmenage, dont il ne cessera plus de se plaindre [11].
Cela dit, il ne passe jamais à l’acte, pris de scrupules qui l’emportent chaque fois sur l’exaspération et dont une de ses lettres à Luc Durtain, ayant demandé en mars 1939 à être déchargé de ses obligations dans Ce soir, éclaire parfaitement la nature [12] :
« Je ne peux pas te dire que je ne comprends pas tes raisons. Je souffre moi-même à tel point d’être séparé de mon travail par les travaux que j’ai acceptés ailleurs... Et si je ne quitte pas tout, si je ne dépose pas ce terrible manteau de fatigues que le journal jette, jour après jour, sur mes épaules, c’est que, dans les circonstances que nous traversons depuis l’été dernier, mon départ aurait l’air d’un désaveu dont je ne pourrais supporter l’idée. »
Un autre argument du Brouillon de lettre pour justifier une acceptation « limitée à la mise en route du travail » est en revanche d’ordre littéraire et les scrupules et les sentiments de remords qu’il implique prouvent que le mensonge du « travail solitaire », dans la lettre du 21 octobre 37, n’était en somme que la traduction d’un regret (d’un vieux regret, à vrai dire), l’envers d’un rêve impossible :
« La principale qualité qu’un écrivain peut apporter dans la vie militante est sa valeur propre d’écrivain. Celle-ci vient-elle à s’affaiblir, le crédit moral du militant en est touché d’autant. [...] Ce n’est pas en tant que rédacteur en chef d’un quotidien d’information qu’un Jean-Richard Bloch, non plus que tel autre de ses confrères, peut vous rendre les plus grands services, mais en écrivant ses livres . » [13]
Ces préoccupations d’écrivain dont on comprend sans peine les motivations profondes, n’en sont pas moins annulées – le terme n’est pas trop fort – par celles du militant qui, depuis des années ne laissait plus aucun doute sur les priorités du moment : « L’heure est aux combattants, non aux historiens. L’heure est aux actes, et non à la méditation sur les actes. » [14]
Au moment d’embarquer avec Aragon dans la « galère » de Ce soir, Jean-Richard Bloch, sans doute, se souvient-il encore des cieux, et il tient à définir, au moins au niveau des principes, le statut particulier et le caractère privilégié de la création littéraire dans ses rapports avec la vie militante. On n’en a pas moins l’impression que c’est là un simulacre de combat, et encore d’arrière-garde. Son évolution, depuis 1934, est irréversible ; ce n’est plus le même homme qui, dans Destin du siècle, soutenait encore [15]. :
« Mon métier n’est pas de tirer des conclusions. Du moins pour autrui. Je ne suis pas marchand de recettes. [...]
Seul l’homo politicus va d’abord à la solution. Je ne suis pas un homme politique. [...] Et je n’adresse pas mon discours aux hommes politiques. Ils perdraient leur temps avec moi. Ils le savent bien. Je ne l’adresse qu’aux artisans de mon espèce. [...] Mon métier consiste dans les mots, dans la connaissance du poids, du volume, de la densité des mots, leur maniement, leur usage, leur exacte application. »
Il est vrai que, dans ce même texte, un peu plus loin (p.26), on tombe en arrêt devant un passage qui a presque quelque chose de prémonitoire :
« La tâche que je me suis assignée dans ce livre est la plus conforme à mes capacités en tant qu’essayiste. Je ne dis pas qu’en d’autres temps et d’autres pays, poussé au désespoir par un fascisme ou un tzarisme, je n’eusse pas fait (de grand cœur, avec un enthousiasme joyeux et viril) un homme d’action, tout comme Trotsky eût fait, en France ou en Angleterre, un homme de science. (Il le laisse entendre dans le récit de sa vie et il faut l’en croire.) »
Et Jean-Richard Bloch qui connaît depuis sa jeunesse la vie des militants, de décrire en ces termes leur situation, telle qu’elle est devenue depuis la fin de la guerre :
« Coupé de sa mystique ancienne par le ralliement général des socialistes à la guerre, en 1914, et coupé de sa mystique nouvelle par sa rupture avec le bolchevisme, le socialisme de 1931 expérimente, les unes après les autres, différentes formules, des vieilles, des neuves, et s’étonne de leur faible efficacité. Le militant d’après-guerre est dans la même situation tragique et bouffonne à la fois que l’artiste de ce temps. » (p.21-22)
Récapitulons. Deux considérations – l’épuisement physique et nerveux, une certaine idée de la mission de l’écrivain – sont à l’origine de l’hésitation d’abord, du caractère « temporaire » de l’acceptation ensuite. Il y a néanmoins acceptation et on se demande ce qui a pu la déterminer. Que le témoignage d’Aragon soit sur ce point sujet à caution, on ne s’en étonnera pas outre mesure, mais est-ce à dire que sa version relève du pur imaginaire lorsqu’il affirme : « Il fut moins étonné que moi de la proposition qui m’avait été faite, et assez tenté d’être d’emblée associé à cette curieuse entreprise (p.226). »
Curieuse, elle l’était en effet, cette entreprise, puisqu’il était question, comme l’explique Aragon lui-même, « de créer un organe indépendant répondant à un public croissant que les journaux du soir existants ne satisfaisaient pas ». Et Aragon de préciser : « Il ne s’agissait pas du tout de créer un organe communiste. Mais alors pourquoi avait-on pensé à moi pour le diriger ? » Cette phrase à elle seule, avec la feinte du narrateur qui dissimule son « omniscience », montre à quel point Aragon est en train de construire ici (p. 123) un récit. « Toujours est-il que Maurice Thorez m’avait demandé d’accepter ce travail, même si, comme je craignais, cela pouvait constituer un poids assez lourd pour freiner mon activité d’écrivain. Je devais comprendre que, par là, je pouvais contribuer d’une façon efficace à une certaine modification de l’esprit public, largement amorcée sur le plan politique après les élections de mai. » C’est là que Jean-Richard Bloch fait son entrée dans cette histoire : « je pris sur moi, raconte Aragon, de faire dépendre ma réponse de celle d’un homme qui n’était pas de mon parti, si on lui proposait de partager avec moi la direction de ce nouveau journal. Avais-je, ce disant, quelqu’un en vue ? Bien sûr. Jean-Richard Bloch. Mais accepterait-il ? Je fis le voyage de Poitiers pour le lui demander (p.225-226). »
Pour que Jean-Richard Bloch finisse par accepter, sans doute fallait-il qu’il fût « cuisiné » par quelqu’un d’aussi habile qu’Aragon, mais il fallait aussi qu’il fût lui-même suffisamment réceptif aux arguments de ce dernier que le texte qu’on vient de citer de lui résume assez bien. Quelques années plus tôt, il avait résisté encore à son éloquence : « Nous sommes restés, raconte-t-il à sa femme [16] , cinq heures ensemble et il a parlé à peu près tout le temps, avec une dévorante envie de me convaincre, me séduire, m’avoir. Il est incontestablement intelligent, dans le sens large du mot, et pénétrant. Malraux et lui, quelle étrange équipe. Frères ennemis, d’ailleurs. Il m’a exprimé toute sa profonde méfiance pour l’autre. »
Cette fois, il se laisse convaincre par le « charmant » Aragon [17] . Rappelons à ce propos que les témoignages sur le pouvoir de séduction d’Aragon sont nombreux. Prenons à titre d’exemple cette remarque du journal de Romain Rolland, du 29 juin 1937 [18] : « Aragon, charmant, câlin, séduisant, comme c’est sa nature » ; ou encore le témoignage de Claude Morgan [19] : « Aragon a besoin de séduire. Pour y parvenir, il fait ce qu’il faut, dépensant des trésors d’ingéniosité, d’attention, de délicatesse. Est-ce sincère ? est-ce calcul ? probablement l’un et l’autre. » Quant à Aragon, dans ses souvenirs de 1976, il fera dater son amitié avec J.-R. Bloch du mois de septembre 1936, tout en précisant (p.198) : « Jusque-là, les rapports entre nous étaient assez distants, sauf que nous nous étions trouvés du même bord dans le comité d’Europe pour la défense de cette revue. » Au moment de la rédaction du Brouillon de lettre, J.-R. Bloch lui-même considère Aragon comme un ami, en insistant à la fin de sa lettre sur le fait qu’il est « assurément aussi l’homme avec lequel il m’eût été le plus agréable et le plus facile de travailler ».
Cependant, au-delà des qualités personnelles d’Aragon, l’idée même de ce journal devait plaire à J.-R. Bloch dans la mesure où elle répondait à ses propres préoccupations, lesquelles rejoignaient à vrai dire celles de nombreux intellectuels de gauche de l’époque, désireux de toucher les masses. Dans le N° 41 de Commune, par exemple, en janvier 1937 précisément, René Blech, secrétaire général des cercles des Amis de Commune, ne proclamait-il pas la nécessité de « trouver les liaisons et les moyens de propagande qui permettent de toucher les plus grosses masses », avec à l’appui cet argument [20] : « Se contenter du public d’un parti ou d’un milieu intellectuel est chose insuffisante ; il faut amener cette foule, qui ne demande qu’à écouter, s’instruire, se distraire, aux meilleures réalisations culturelles... » Bloch, on peut, certes, le croire quand il affirme qu’il a d’abord discuté ferme, d’autant plus qu’il avait en plus des scrupules qui lui venaient de son inexpérience dans ce domaine : « Enfin, écrivait-il aux dirigeants du PCF, puisque je viens de prononcer le mot compétence, laissez-moi vous avouer que, si j’étais décidé à apporter à ces occupations nouvelles tout mon zèle, tout mon désir de bien faire, il n’en reste pas moins qu’aucun métier ne s’improvise – celui-là moins qu’un autre, – que je suis neuf dans le journalisme, – qu’on ne débute pas dans une carrière par le grade de général, – et que la grande information surtout exige une expérience accomplie. » Mais la création d’un grand journal promettait une certaine prise sur la réalité grâce à l’influence qu’on pouvait espérer exercer par là sur les esprits. Ne disait-il pas, dans un de ses Commentaires d’Europe, en 1935 (Gratitude à Mussolini) : « N’allons pas médire des masses ou les dédaigner. Au bout du compte ce sont elles qui auront le dernier mot. Elles constituent la grande réserve de l’humanité. Ce sont elles qui sauveront la civilisation. Mais on sait comme il est long de les éveiller, combien d’efforts pénibles et harassants ! »
Pour Jean-Richard Bloch, l’enjeu de cette entreprise dépasse d’ailleurs de loin son utilité immédiate dans le combat qu’on menait pour conjurer la montée des périls. Au moment de s’engager à la direction de Ce soir, il s’est déjà forgé toute une philosophie qui le poussait irrésistiblement vers des solutions radicales, en l’occurrence les solutions proposées par le communisme et le marxisme contemporains. Lorsque son ami André Monglond, ayant lu Espagne, Espagne ! et Naissance d’une culture, lui fait remarquer : « Il y a dans la générosité de votre ardeur je ne sais quoi de chrétien qui s’ignore », il lui envoie une réponse qui en dit long sur l’évolution de son esprit [21] :
« Chrétien, dites-vous de moi ? Je le serais avec délices, Monglond, si je n’étais pas convaincu de deux choses : la première c’est que nous n’avons pas le droit de différer la solution par un transfert dans le transcendant ; c’est ici-bas, dans la crotte et l’immanent, qu’il faut faire notre salut et à la fois notre pauvre paradis.
La seconde, c’est que je crois qu’il y a deux morales fort différentes : Celle de l’individu ; le Bouddah [sic], le Christ, les sept Sages, Confucius ont trouvé là-dessus tout ce qu’il y avait à trouver ; [...] Mais, ce bonhomme, cette monade, cet unique, ce solitaire muni, mettez-le en société, faites-le vivre en troupeau, et vous êtes étonné de constater que rien ne colle plus.
La morale individuelle, si parfaite soit-elle, et si riche de leçons valables pour chacun de nous, ne supporte pas le passage au collectif. Les règles, les lois, les prescriptions qui font le chrétien vertueux n’ont jamais pu faire une société chrétienne vertueuse. [...]
La science de l’homme et de son esprit (âme) est une vieille science arrivée à un haut degré d’élaboration. La science de la masse, de la société humaine, est à ses débuts. Elle a ses lois encore obscures, ses méthodes encore hésitantes. Et la masse grossit avec une vitesse si terrifiante qu’il y a comme une course de vitesse entre ces peuples de plus en plus exigeants et cette morale toujours inefficace mais qui ne le restera plus longtemps. »
Cependant, dans la mesure même où Jean-Richard Bloch se rapproche des communistes, et tout particulièrement au moment de son engagement à la direction de Ce soir, son honnêteté foncière lui ordonne de clarifier sa position. Même si Aragon, probablement, ne lui révèle pas tous les dessous de l’entreprise, il en apprend assez pour se sentir mal à l’aise, et ce malaise est à l’origine de sa troisième réserve, celle que dans son Brouillon de lettre il croit devoir développer le plus longuement.
« Il est également de la plus grande importance, explique-t-il à ses camarades, que J. R. B. garde l’indépendance absolue à l’égard de « l’or de Moscou » qui a fait jusqu’à présent sa force et celle de son témoignage. Depuis que je milite dans les rangs du socialisme [...], j’ai été l’objet de bien des insultes. Mais [...] jamais personne n’a pu me reprocher d’avoir trouvé un avantage matériel dans mon attitude politique. [...] Il est de la première importance que cet état de choses, si pénible qu’il puisse être pour moi, ne cesse pas. Il ne faut pas qu’à aucun moment, soit dans une salle de réunion, soit dans la presse, un ennemi puisse me crier : « Combien touchez-vous pour dire ce que vous dites là ? »
Car ce qui fait véritablement problème, ce n’est finalement pas le financement du journal, puisque Bloch fait remarquer : « la fiction selon laquelle notre futur journal aura sa trésorerie assurée indépendamment de toute participation indirecte d’un Parti politique est de celles qui ne durent qu’un matin »... Non, le vrai problème, c’est que lui, Bloch, tout convaincu qu’il soit de l’opportunité de lancer un tel journal, idée approuvée du reste par Léon Blum si l’on en croit Marguerite Jean-Richard Bloch [22], le vrai problème, c’est qu’il doit entrer à la direction de Ce soir en qualité de directeur indépendant. Sachant « à quel point l’opinion publique est chatouilleuse sur ce terrain » (qui est celui de la corruption de la presse), il estime pour sa part « qu’il serait presque moins grave, en ce qui concerne ma présomption d’indépendance, d’accepter la même rémunération de mon travail dans un organisme publiquement contrôlé par le Parti ». C’est précisément parce qu’il se sait maintenant entièrement solidaire avec ce parti qu’il lui répugne d’être éventuellement pris pour un simple agent payé (« l’alternative d’avoir à choisir entre le rôle de trompeur ou celui de trompé, – celui de dupeur ou celui de niais »). Et il insiste sur ce point délicat avec force, comme par crainte de n’être pas suffisamment bien compris :
« Je ne crains pas la bataille. Toute ma vie en témoigne [...]. Mais j’ai toujours eu soin de choisir mes terrains. Je ne me bats bien qu’à visage découvert. Seul un fascisme nous obligeant à l’illégalité me ferait accepter de porter un masque. Je soutiendrais fort mal un débat ou une polémique où il me serait impossible de reproduire au grand jour des justifications de ma situation personnelle et où je devrais user de restrictions de conscience. »
Mais il faut lire aussi la suite, car elle permet de mesurer la profondeur de la révision à laquelle Jean-Richard est en train de soumettre ses convictions d’autrefois. Déjà, tout à l’heure, on a vu surgir de sous sa plume un terme pour le moins inattendu, celui de « présomption d’indépendance » : l’expression ne trahissait-elle pas comme un trouble, comme un affaiblissement des positions antérieures, une disposition en tout cas à céder sur ce terrain pour les besoins de la cause ? Plutôt que de « porter un masque », il préférerait partager la condition du militant communiste, « à visage découvert » :
« Je répète que le cas n’est pas du tout le même pour un membre du Parti dont tout le monde sait qu’il exécute les tâches qui lui sont assignées ; cela est reconnu et admis par tous. »
Tous ces scrupules, c’est l’évidence même, ne sont pas d’ordre politique, puisqu’à la fin de sa lettre, il dit toute sa gratitude « pour la marque de confiance et d’estime » qu’on vient de lui donner et parle des « idées que nous servons en commun ». Il est non moins évident qu’il accepte sans difficulté le principe même d’un journal « indépendant » dont il sait pourtant qu’il n’est qu’une fiction. Ce qui le gêne, c’est sa propre situation dont l’ambiguïté ne lui échappe pas. Le seul moyen alors de retrouver une transparence menacée, c’est de rejoindre publiquement le Parti communiste. Ce qui fut fait. Mais à quel moment au juste ?
À en croire Aragon, c’est au congrès d’Arles, en décembre 1937, que Jean-Richard Bloch a donné son adhésion au Parti [23]. Son témoignage, qui est une fois de plus un véritable récit, rien ne nous autorise en ce moment à le récuser, quoique, d’un autre côté, on ne dispose en fait d’aucune preuve, d’aucun document qui puisse l’étayer. Des questions se posent de toute façon, quand on lit par exemple telle note de journal de Romain Rolland, datée du 23 mars 1938 et dont nous apprenons qu’elle a été consignée après une visite d’Aragon [24] : « Des écrivains français, affirme Romain Rolland, bien peu des plus marquants sont des communisants sûrs. Le seul, de renom, qui soit inscrit au Parti est Aragon. » On pense aussi au discours de Jacques Duclos aux funérailles de l’écrivain : il a évoqué l’adhésion de Jean-Richard Bloch au Parti en des termes qui ne font certainement pas penser au congrès d’Arles [25] : « Jean-Richard Bloch se dressa contre la politique de trahison de Munich. Pour combattre cette politique anti-française il fonda, avec Aragon, le journal Ce soir et il choisit ce moment difficile pour donner son adhésion à notre Parti Communiste Français ; il n’était pas venu aux jours faciles ; il venait à l’heure des combats, à l’heure des difficultés. » Faut-il rappeler qu’au moment du congrès d’Arles, on n’avait point encore, et pour cause, le sentiment de vivre un moment difficile ? Ne s’agirait-il donc pas plutôt de l’année 1939 ?
Quoi qu’il en soit, le fait même de l’adhésion n’étant contesté par personne, on peut penser avec Jean Albertini [26] qu’elle fut en fait inséparable de « son expérience concrète à Ce Soir ». À condition toutefois d’inclure dans cette expérience le voyage d’Aragon à Poitiers et les premiers jours de réflexions et de consultations de Jean-Richard Bloch, ainsi que le témoignage de ce brouillon de lettre retrouvé qui nous permet maintenant de discerner un peu mieux toute la complexité comme aussi le caractère extrêmement contraignant de cette aventure. Car si l’adhésion a pu résoudre le dilemme de la transparence, celui, angoissant, de la vocation littéraire demeurait insoluble, Ce soir s’étant transformé en effet en une galère qui ne lâchait plus son prisonnier volontaire et récalcitrant à la fois.
« Quant à mon travail, se plaignait-il le 27 juin 1939 à Romain Rolland, [...] mieux vaut n’y pas songer. Le soir, épuisé, je ne peux que m’endormir, comme une bête. J’attends avec impatience le retour de vacances de l’ami Aragon pour m’en aller – vers le 10 juillet. Mais auparavant j’aurai réglé mes affaires avec nos amis ; ou bien ils auront trouvé quelque solution (qu’à vrai dire je n’aperçois point) qui me rende des possibilités de travail, et de concentration, – ou bien je quitterai le journal, je demanderai à être relevé de mon poste de guet et à retourner à ma solitude laborieuse. »
Était-il cette fois vraiment décidé ? De toute façon, il était trop tard. Le siècle marchait à grands pas vers de nouvelles catastrophes qui devaient l’empêcher à jamais de retrouver la solitude laborieuse.
